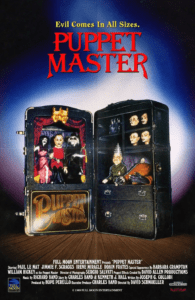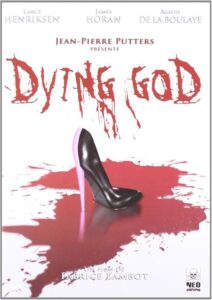Réalisateur : Richard Loncraine
Année de Sortie : 1977
Origine : Royaume Uni / Canada
Genre : Fantastique
Durée : 1h38
Thibaud Savignol : 7/10
Le Cercle des enfants disparus
Grand cru que l’année 1977 pour le cinéma fantastique. Ce fantastique qui misait avant tout sur le mystère, des décors imposants et sa musique pour créer une ambiance à la fois envoûtante et terrifiante, avant de nous retourner l’esprit lors de séquences finales révélatrices. Dario Argento, dans une veine des plus baroques nous livrait la merveille qu’est Suspiria, Michael Winner, lassé de dessouder de la racaille par paquets de douze réalisait La Sentinelle des maudits, vrai cauchemar éveillé, tandis que le vétéran Robert Wise, 15 ans après son classique La Maison du diable, nous offrait une nouvelle vision du fantastique domestique dans Audrey Rose. Et c’est en cette année faste que le second film de Richard Loncraine sort en salles. Coproduit entre l’Angleterre et le Canada, nanti d’un budget que l’on devine modeste, le projet parvient à attirer dans ses filets Mia Farrow, inoubliable dans Rosemary’s Baby et ayant collaboré avec plusieurs grands réalisateurs depuis tels que Richard Fleischer et Claude Chabrol. Le Cercle infernal est la seule incursion dans le fantastique pour un cinéaste qui lorgnera plus du côté dramatique ou du biopic lors de ses prochaines réalisations. Il parviendra même à remporter l’ours d’argent du meilleur réalisateur à la Berlinale de 1996 pour Richard III.
Dès les premières minutes du film le drame survient. Lors d’un petit-déjeuner en apparence banal, la jeune Lily s’étouffe en mangeant une pomme. Malgré les tentatives des parents, l’enfant ne parvient pas à dégager sa trachée. Sa mère Julia tente alors le tout pour le tout en ouvrant directement au couteau la gorge de sa fille afin d’en extraire l’objet de souffrance. Malheureusement l’acte tourne à la catastrophe, l’enfant meurt. Après quelques jours d’hospitalisation Julia sort et décide de quitter son mari. Elle loue un nouveau logement pour s’y installer, une grande demeure victorienne au centre de Londres. Endeuillée, elle commence à sentir une présence dans différentes pièces. Elle se met alors à croire à des signes de l’au-delà de la part de sa fille décédée.

Pour illustrer ce ressenti, Loncraine exploite son décor avec une grande ingéniosité. Utilisant le format scope à la perfection, chaque plan se compose grâce au vide laissé dans les différentes pièces, nous poussant à scruter le moindre recoin en vue de détecter à notre tour une présence. La bâtisse, trop grande pour une seule personne, devient le véritable centre d’attention de l’œil du spectateur. Un bruit, un craquement, une ombre, tout est objet de peur. Cette mise en scène élégante, où chaque mouvement d’appareil est employé pour révéler (ou non) un élément déterminant, nous agrippe et nous fait partager le point de vue de l’héroïne. Pas d’effet grossier, pas de jump-scare putassier, tout est ici question de dosage, de rythme, créant une ambiance hypnotisante où chaque possible apparition provoque l’effroi. S’appuyant sur ce minimalisme appliqué et une partition au diapason, Loncraine délivre des séquences de pure terreur.
Harcelée par son mari qui veut à tout prix l’emmener faire consulter, Julia persiste et croit à la possible présence de sa fille à travers les signes qu’elle interprète. Le voile est finalement levé lors d’une séance de spiritisme éprouvante. Oui, il y a une présence en ces lieux, mais pas forcément celle que l’on pense. Et le film de bifurquer alors sur le terrain du thriller, n’oubliant jamais sa toile de fond fantastique. Julia va investiguer, déterrer un passé trouble, mêlant germanophobie exacerbée au lendemain de la guerre et cruauté enfantine insoupçonnée. Dès lors, les intrigues se mêlent, deviennent inextricables. Le récit réussit son numéro d’équilibriste, joue avec nos nerfs et s’enfonce irrémédiablement dans l’horreur et la folie.
Primé au festival d’Avoriaz 1978, le film est injustement tombé dans l’oubli au fil des ans. Désormais visible grâce à une sublime copie restaurée chez le Chat qui Fume, Le Cercle infernal mérite d’être réhabilité dans la grande histoire du cinéma fantastique. Mêlant habilement drame humain, frissons et psychologie, le métrage bénéficie également d’une Mia Farrow habitée, parfaite en femme blessée mais battante.
Conséquence d’un parcours tortueux, le film se conclut alors sur un plan séquence tétanisant, épilogue bouleversant d’un deuil impossible.