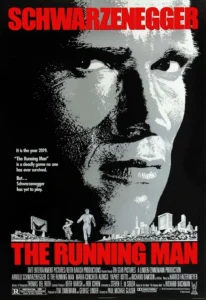Réalisateur : Gabriele Salvatores
Année de Sortie : 1997
Origine : Italie / France / Royaume-Uni
Genre : Science-Fiction Mystique
Durée : 1h54
Le Roy du Bis : 7/10
Thibaud Savignol : 7/10
Septième Ciel Virtuel
Il n’est jamais facile de se retrouver seul à aimer ou défendre un film. Chacun ses goûts comme dirait l’autre, mais on a vite fait de s’interroger lorsque notre ressenti se trouve de l’autre côté de l’appréciation générale. Même si certains ont fait du désaccord leur identité ou leur fond de commerce, à s’ériger en contrepoint sur les films appréciés du grand public. On peut être capables par moments de reconnaître la faiblesse d’une œuvre mais la prendre toutefois en affection. Mais parfois, on ne comprend juste pas l’avis général, pourquoi un film a été rejeté ou est tombé dans l’oubli. Comme cette introduction subtile le laisse suggérer, c’est le cas ici en ce qui concerne Nirvana.
A redécouvrir d’urgence
Peu connu, mais pas tombé en désuétude non plus, le film ne recueille pas énormément de critiques favorables à son égard. Sorti en 1997, LA décennie de la représentation du virtuel sur grand écran, il s’inscrit à première vue dans le sillage d’œuvres telles que Johnny Mnemonic, Le Cobaye ou encore Hackers. Jimi, un célèbre programmeur de jeux vidéo découvre que l’avatar de son nouveau jeu vient de prendre conscience de sa propre existence, et souffre des boucles de gameplay auxquelles il est confronté. Accablé par son désarroi, il décide de s’allier au hacker Joystick (la subtilité des nineties) afin de pirater les données de son employeur et rendre libre sa création.
Évacuons d’entrée les défauts du film, car oui il y en a. Une fois la trame amorcée et les enjeux posés, le scénario affiche ses limites, se montre parfois répétitif et peine à s’emballer avant son dernier acte. Peu d’éléments perturbateurs viennent entraver la progression de nos protagonistes, condamnés par moment à répéter les mêmes gestes, à l’image de Solo bloqué dans son univers vidéoludique. Même si l’analogie pourrait se révéler pertinente à la lumière du cœur du film, le résultat s’apparente plutôt à quelques longueurs dispensables. Un quart d’heure de trop dont la coupe aurait à coup sûr servi les intérêts du film, créant une véritable dynamique qui fait parfois défaut.

S’ajoute à cela un budget de 10 millions de dollars, dérisoire au vu des ambitions du long-métrage. Pourtant, tout l’argent se voit à l’écran grâce à un travail d’atmosphère et une direction artistique qui rendent hommage au sous-genre qu’il représente. Car oui, la grande force de Nirvana, sa qualité principale, c’est d’embrasser une philosophie Cyberpunk totale, dans le fond, mais tout d’abord grâce à une forme soignée et sacrément inventive. Les décors, tournés pour la plupart dans l’usine désaffectée d’Alfa Roméo à Milan, illustrent une ville tourmentée, où les quartiers pauvres subsistent tant bien que mal, tandis que les multinationales empochent le pactole loin de la crasse environnante.
Un film monde
Jimi, le développeur, bien à l’abri dans son appartement immense et technologique, va ainsi plonger dans les bas fonds, côtoyer la misère et la violence pour à son tour retourner le système contre lui-même. Impossible de ne pas penser à Blade Runner, à ses rues grouillants de miséreux aux looks futuro-punk, à ses échoppes de quartiers minuscules et où l’éclairage public s’est néontisé. La pluie omniprésente du classique de Scott se voit remplacer par la délicatesse des flocons de neige, qui donnent au film une image terminale d’une douceur infinie.
Cette quête de justice, baladant le personnage parmi une galerie de lieux à l’identité marquée (quartiers arabe, indien, asiatique), est l’occasion de découvrir tout cet univers, et notamment son fonctionnement. Que ce soit à travers des prothèses oculaires, des réceptacles pour mémoire intégrés au cerveau ou encore des puces contenant les souvenirs d’un individu, chaque péripétie est l’occasion d’en apprendre toujours plus et de développer en profondeur l’univers. Contrairement à nombre de films estampillés Cyberpunk qui n’en n’ont que l’appellation via une esthétique de façade et des thématiques jamais approfondies, Nirvana fait de ce sous-genre le cœur même de son film, embrasse ses visuels atypiques en même temps que sa philosophie underground.
Derrière cette direction artistique totalement raccord et féconde, se cache moult références, avant tout littéraires. La filiation la plus évidente, presque inévitable, c’est avec Neuromancien de William Gibson, l’œuvre matricielle de tout ce courant : on y suit des hackers s’attaquant à des multinationales et on parle déjà de console, de matrice, de données numériques. Tout le lexique y est, et toutes les bases fondatrices d’un nouveau sous-genre de la science fiction. En parallèle, Nirvana puise énormément dans Le Samouraï virtuel de Neal Stephenson, où il est question de metavers, de la collusion entre nos deux mondes, sans oublier des personnages qui font front commun pour arrêter la propagation d’un virus, ce qui se produira dans le dernier acte du film.

Cyberpunk dans l’âme
Malgré sa simplicité apparente, le scénario transpire un amour véritable et sincère pour ce genre, multipliant les liens entre les œuvres. Les scénaristes n’ont de cesse, à chaque étape, de raccorder leur écriture à leurs influences visuelles. La grande réussite de l’œuvre se trouve ici, aux confluent de deux styles de création, alliant parfaitement ses thématiques à ses images. En plus de Blade Runner, on pense à Tetsuo, Robocop ou encore le film d’animation Ghost in The Shell, qui a fusionné comme jamais les interrogations funestes du genre à un trait épuré d’une perfection rarement égalée.
Derrière le réveil d’un avatar de jeu vidéo, se dresse en filigrane les mêmes questions que le classique de Mamoru Oshii, à savoir si une intelligence artificielle pourra potentiellement un jour se conscientiser, fantasme de science-fiction déjà à l’œuvre dans la saga Terminator. Là où nombre de fictions ont recours dans les années 90 à des modélisations 3D au mieux attachantes, au pire terriblement surannées, Nirvana met en scène une représentation du virtuel beaucoup plus terre à terre. Loin des écrans chiffrés incompréhensibles et de réseaux numériques abstraits, le virtuel n’est que la prolongation déformée du réel.
Ainsi les personnages du jeu vidéo en question évoluent au sein d’une ville tout à fait reconnaissable et assimilable aux nôtres. Pour noter sa particularité, des filtres noir et blanc ainsi que des touches de couleurs permettent la différenciation. Ce refus du tout numérique pour représenter cette univers factice floute les frontières, comme si le virtuel n’était pas un autre monde, mais un nouveau monde, terrain d’émancipation humaine.
Le concept sera poussé à son paroxysme dans le dernier acte, peut être par manque de budget mais peu importe, lorsque Jimi se connectera au sein des réseaux de la multinationale. Il déambule alors au sein de pièces à l’existence tangible, rencontrant des personnages de chair et de sang comme lui : son ex-femme, son père. Plus qu’un microcosme parallèle au notre, le virtuel apparaît dès lors comme l’étape suivante pour une humanité sur le déclin.

La religion numérique
Se substituant aux célèbres «Tears in the Rain» de Rutger Hauer en 1982, Christophe Lambert bouleverse tout autant, lorsqu’il laisse échapper sa propre création dans les limbes de l’informatisation, comparant cette liberté à de doux flocons de neige. Une filiation loin d’être anodine ; les plus vieux se souviendront de leur téléviseur à l’image parasitée lorsque le signal était trop faible. Dans les années 90, on parlait d’une image enneigée. Poursuivant sa réflexion d’un ailleurs inédit, le film confronte également le virtuel aux pensées mystiques.
Citons cette séquence dans les dédales souterrains de la mégalopole, au thème hindouiste, où les autels divins sont remplacés par des offrandes numériques et une vénération des augmentations corporelles. Le virtuel et l’évolution numérique s’accomplissent comme une nouvelle croyance, avec ses nouveaux rites et divinités, comme porte d’accès à un monde meilleur. Toutes les composantes d’un monde transfiguré par les évolutions technologiques sont mise en scènes, explorant toutes les facettes du Cyberpunk, un genre souvent prétexte à un aspect futuriste dénué de la moindre portée philosophique.
On se surprend presque à y voir, sur certains aspect, un prologue digital au cultisme Truman Show qui sortira l’année suivante : un personnage dont l’existence fictive, scrutée par une puissance supérieure, va être remise en question par ses propres doutes. Sans oublier l’avènement du divertissement des années 2000 par excellence, la télé-réalité : observer l’autre derrière un écran, jouir de son statut de spectateur actif, sans accéder à la transcende physique qui accompagne les expériences diffusées sur la petite lucarne. Le début d’une vie par procuration.
Plus que les limbes auxquelles il est condamné depuis sa sortie, Nirvana est l’une des plus belles œuvres Cyberpunk jamais réalisées. Imparfaite, fauchée, elle déploie pourtant des trésors d’ingéniosité pour rendre son univers crédible, fidèle à la doctrine de ce sous-genre de la science-fiction, sans cesser de nous interroger sur notre rapport au virtuel et à ses expérimentations. Plus de 25 ans après sa sortie, voilà un film qui mériterait bien qu’un éditeur se penche sur le sujet en vue d’une ressortie dans les meilleures conditions possibles.