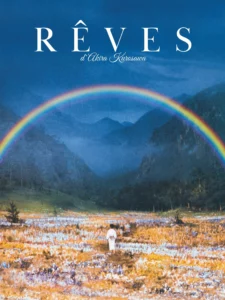Réalisateur : Harold Ramis
Année de Sortie : 1993
Origine : États-Unis
Genre : Boucle Temporelle
Durée : 1h43
Le Roy du Bis : 7.5/10
Thibaud Savignol : 6/10
La Mémoire fait Défaut
Il y a des films qui reviennent immanquablement dans nos vies, comme une ritournelle familière. Des œuvres que l’on revoit sans trop savoir pourquoi, mais dont on ressort chaque fois avec une impression de réconfort et d’évidence. Un jour sans Fin fait partie de ces curiosités cinématographiques qui semblent se régénérer à chaque vision. Peut-être parce qu’il parle de nous, de nos routines cadenassées, de ces journées où tout semble immobile, comme si le temps refusait d’avancer. Peut-être aussi parce qu’il nous rappelle, ironiquement, qu’il existe des répétitions bien plus cruelles que les nôtres.
Même Jour, Nouveau Phil
C’est précisément le calvaire que vit Phil Connors, météorologue cynique et saturé d’amertume, condamné à couvrir chaque année le Jour de la marmotte dans la ville très accueillante mais désespérément monotone de Punxsutawney. Incapable de supporter une nouvelle fois ce folklore rural, le présentateur rêve seulement d’en finir avec ce reportage mineur qui entérine l’immobilisme de sa carrière. Mais le blizzard de la destinée va lui barrer la route et lui faire revivre inlassablement la même putain de journée encore, encore… et encore.
À première vue, il n’y a aucune raison d’intégrer Un jour sans Fin dans un calendrier de l’avent, puisque l’intrigue se déroule en plein mois de février. Pourtant, le film s’y prête étrangement bien avec ses bonhommes de neige, sa philosophie mi-bouddhiste, mi-capraesque, sa recherche de rédemption, d’amour, de réconciliation, de marmotte et de chocolat chaud… Et ce quelque chose d’indéfinissable qui en fait un classique saisonnier depuis 1993. On le revoit comme on ressort les décorations, par habitude, par tendresse, et parce qu’il marche à tous les coups.

Si vous êtes capable de supporter les facéties et l’égo de Bill Murray qui, il faut bien l’admettre n’a certainement jamais été aussi bon que dans ce film, vous devriez allègrement apprécier cette histoire de boucle temporelle se targuant d’être la meilleure que le genre ait produit, sinon la plus connue. Le comédien alternant entre cynisme pur, désespoir glacial et fragilité humaine, incarne un véritable pantin extralucide enfermé dans une pièce de théâtre qu’il connaît par cœur. Phil se retrouve à arpenter cette même journée en long et en travers, comme s’il était coincé dans un purgatoire entre le paradis et l’enfer, reproduisant les mêmes gestes, discours, trajectoires et parcours parfois funestes. On s’attache d’autant plus à lui qu’on imagine aisément ce que l’on ferait à sa place.
« Et la Marmotte, elle met le chocolat dans le papier d’alu ? »
Dans cette répétition sans mémoire, les habitants deviennent de véritables PNJ de chez Bethesda, condamnés à se répéter invariablement à moins qu’on ne vienne se glisser dans leur routine. Et quand plus rien ne semble avoir de sens, ne restent que des tentatives désespérées : conduire en état d’ivresse, braquer un convoyeur de fond, attenter à ses jours en se jetant du haut d’une tour, provoquer un accident… autant de manières d’expérimenter sa propre mort et de troubler l’ordre public sans devoir en subir les conséquences induites. Mais Harold Ramis refuse de pousser l’expérience vers une noirceur absolue. Il laisse planer l’idée d’une misanthropie extrême mais n’y plonge jamais totalement. Au contraire, il guide progressivement son personnage vers une forme d’humanité retrouvée.
A défaut de réellement surprendre, le réalisateur parvient à trouver une véritable harmonie dans sa capacité à orchestrer un chaos répétitif sans jamais perdre le spectateur, alternant comique de répétition, mélancolie, romance, mise en abyme et petites révélations. Phil va donc devoir aborder cette épreuve à la fois comme une chance et une pénitence, et jouer un jeu de rôle grandeur nature en apprenant par cœur la timeline des événements de la journée. Un Jour sans Fin a ceci près de paradoxal que c’est autant dans le contrôle absolu de la partition que dans le «lâcher prise» que réside la solution. C’est en explorant intégralement son environnement et en abordant différemment la routine que celle-ci lui offrira alors de nouveaux horizons ponctués d’épisodes euphoriques, dramatiques voire tragiques.
L’intrigue se transforme alors en une quête rédemptrice, à la fois intime et introspective, interrogeant l’identité de son héros autant que la notion de libre arbitre en posant une question d’ordre philosophique : les actes nous définissent-ils en tant que personne ? Ramis se fait ainsi l’héritier discret de Frank Capra, envoyant son personnage sur les traces de George Bailey dans La Vie est Belle. Phil devient alors un bon samaritain à l’écoute de son prochain, tentant de sauver le clodo du coin ou l’orphelin d’une chute potentiellement mortelle. Et c’est dans cette forme d’épiphanie candide et humaniste que réside toute la beauté de cette comédie saisonnière qui continue de tourner en boucle dans les chaumières.