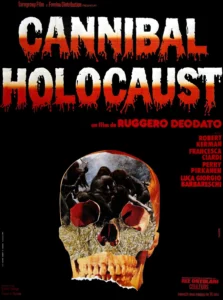Réalisateur : Frank Henenlotter
Année de Sortie : 1982
Origine : États-Unis
Genre : Freak Show
Durée : 1h31
Le Roy du Bis : 7/10
Thibaud Savignol : 5/10
La Main au Panier
Quel plaisir de se replonger dans le New-York cracra des années 80. Celui des peep-show, des petits cinémas de quartier et des projections pornos. C’était aussi le temps de la VHS, du caméscope et des videos nasties. La 42ème rue était envahie par les clodos, les putes, les dealers et les marginaux de tout bord, embarrassant pas mal la municipalité de l’époque. Faut dire qu’il y avait de quoi aussi. Pour quelqu’un ayant grandi dans les années 90, loin de ce microcosme urbain souillé par le vice et la décadence, ce genre de péloche représente la quintessence d’une époque bénie où des cinéastes bravaient les interdits en toute liberté, à l’orée d’une décennie pourtant marquée par les histoires fantastiques de la bande à Spielberg. On est en droit d’éprouver une sincère fascination mélancolique pour ce monde-là, probablement parce que la vie semblait plus proche d’une forme d’anarchie consensuelle accentuée par la misère sociale. Évidemment, cette faune sauvage soulève aussi son lot de mauvaises rencontres et de psychopathes déviants, ce qui en fait implacablement le sujet idéal pour des œuvres underground issues de ce nouveau courant trash et satirique, où l’on s’évertuait à repousser les limites du raisonnable à l’écran.
Franck Henenlotter fut en quelque sorte l’un des pères fondateurs de ce nouveau mouvement contre culturel en marge du système hollywoodien, où les films se tournaient à l’économie de moyen. Les défauts et la pauvreté de la mise en scène ne font qu’en renforcer le degré de sincérité et l’intérêt. D’autant que réalisateur new-yorkais n’est jamais à court d’idées et de trucages pour pallier le manque de budget. L’un de ses meilleurs arguments réside également dans sa complaisance malsaine et gore. Si les résultats de son exploitation en salle furent d’abord décevants, la pierre est à jeter à son distributeur qui avait pris la liberté d’expurger le film de ses meurtres les plus sanglants. Une erreur de jugement qui sera réparée suite à la réussite d’une projection non censurée, permettant enfin à ce Basket Case de voir le haut du panier.

Le film tient sur un pur argument de série B. On suit le quotidien d’un jeune freluquet explorant le New-York interlope avec un panier en osier dans lequel il planque sa deuxième moitié, véritable réduction d’être humain édenté au physique largement repoussant. D’où le choix de l’élever à l’abri des regards indiscrets après que ce dernier fut balancé aux ordures comme un vulgaire déchet. L’idée peut sembler totalement incongrue si l’on considère que le frère siamois mutant possède un appétit vorace malgré l’absence apparente d’un système digestif digne de ce nom, en sus d’être animé par une force surhumaine. Le duo fraternel entreprend en réalité de se venger du chirurgien qui les a autrefois séparés. Mais Belial devient de plus en plus irascible et incontrôlable, déchiquetant le faciès de ses victimes à mesure que Duane s’éloigne et s’émancipe pour filer la parfaite idylle avec une femme qu’il vient de rencontrer. La plus grande force du film est sans nulle doute d’être parvenu a faire naître une réelle connexion télépathique et sentimentale entre une marionnette grossière taillée dans un bloc de résine et un véritable acteur, là où d’autres seraient certainement tombés dans le piège de la parodie filmique.
Cette fascination pour les monstres, que le réalisateur tente d’ailleurs d’humaniser au fur et à mesure de l’avancée du récit, on la retrouve dans l’ensemble de sa filmographie. Elle est souvent mêlée à la déformation du corps, typique du courant body horror. Chez Henenlotter le monstre est la manifestation d’une excroissance pathologique et névrosée du héros, comme Elmer le verre solitaire, la femme aux 7 clitoris de Bad Biology, ou bien le docteur fou de Frankenhooker qui tente de ramener sa femme à la vie grâce aux dépouilles des prostituées qu’il récupère. Si le reste de sa filmographie sera plutôt placé sous le ton de la comédie, l’ambiance s’avère ici plus dérangeante et bâtarde, l’atmosphère des lieux comme l’hôtel de passes dans lequel vivent les protagonistes étant particulièrement glauque à souhait.
Le film prend fin d’une manière extrêmement cruelle et tragique laissant cette impression de désenchantement et de désespoir absolu. On ne rigole jamais vraiment devant. Ce sont plutôt les sentiments d’inconfort et de gêne qui prédominent à l’issue du visionnage face à ce théâtre du bizarre. Mais c’est aussi ce qui participe à l’acceptation de la différence vers laquelle tend le réalisateur et qu’il creusera d’ailleurs dans ses suites, notamment avec le formidable Basket Case 2 qui se rapproche beaucoup de l’univers de Clive Barker et de son Cabal paru en fin décennie. Malgré la sauvagerie et la brutalité de ce petit bout de chair atrophié, on finit vraiment par s’y attacher, notamment lorsqu’il tente de surmonter le traumatisme et la frustration inhérente à sa condition.